La première chose qui saute aux yeux est la question « carte ». En effet, aucun migrant ne voulait ou avait besoin de consulter une carte géographique avant et en cours de balade. C’était déconcertant car mes bonnes intentions, nourries d’une humeur gaie, de leur montrer le trajet que j’avais choisi en amont, s’évaporaient devant les bouches béantes et les regards perplexes de mes camarades. Même mes efforts de leur faire comprendre, sur carte, les lieux que nous allions visiter semblaient vains.
Il est curieux de noter que, moi aussi, au début, je réagissais bouche bée. Sans le vouloir, je projetais sur eux ma croyance que le repérage dans les lieux et l’espace se construit par rapport à la carte géographique. Déjà, en parlant avec des garçons afghans et d’Afrique sur les lieux urbains qu’ils auraient aimé visiter, on voyait qu’ils avaient des repères spatiaux (le centre commercial de la Part-Dieu « pour s’appeler entre amis » – C., jeune burkinabé-, le quartier de Garibaldi, le marché de Villeurbanne qui selon beaucoup d’entre eux n’est pas cher). Au fil du temps, ce détachement de la carte se produisait en toutes situations, signe évident que les participants aux balades avaient dans leurs cultures un rapport aux espaces différent du nôtre.
Finalement, ce déni rapide de la carte m’a avantagé dans ma démarche de dérive situationniste. En fait, pour De Certeau (1990), la carte sert une gestion fonctionnaliste de l’espace et occulte la trame des marches singulières par des signes conventionnels rejetant la valeur de l’histoire. Ainsi, en « flottant » dans la ville, on s’émancipait non seulement de l’objet encombrant qu’il aurait fallu extraire et redéployer chaque fois, mais aussi, de ce qu’il représente, des parcours établis et à choisir rationnellement. C’était déjà un signe de l’influence du lien entre mes compagnons marcheurs et moi en balade. En effet, y aurait-il eu du sens à ce que j’insiste à exhiber ou attirer l’attention sur la carte quand cela ne faisait pas sens, pas sens « commun » ?
On rejetait donc le support de la carte et on se laissait transporter par nos pas, le long des méandres des routes souvent « incertaines » (dans le quartier proche comme dans Lyon centre, les paysages n’étaient pas tous connus par mes compagnons, ni par moi d’ailleurs), en empruntant aussi des chemins de traverse loin des axes principaux. Dans le quartier proche, plus d’une fois, j’ai ouvert à mes amis le chemin vers le Canal de Jonage. Un espace plus naturel et paisible, non loin du complexe routier de Vaulx-en-Velin La Soie. Nous passions par une rue discrète, d’ailleurs réservée aux vélos !
Parfois, il nous est de même arrivé de terminer le tour du quartier ou de Lyon par des voies que je n’avais pas « prévues » dans mon itinéraire imaginaire. Ainsi, le 16 février, vers la fin de la balade, mes compagnons soudanais en avaient un peu marre (les mots révélateurs « Now come back CAO ? » – de A. soudanais -, les postures quelques mètres derrière moi à pianoter sur leur portable). J’ai décidé de raccourcir le chemin du retour sans passer « visiter » le pôle tertiaire de l’ALSTOM. « Allez, on va en finir avec ça » pensais-je. J’étais sûr qu’à divers moments les autres aussi devaient l’avoir pensé. Lors du tour au Parc de la tête d’Or en avril, pas de carte pour arriver au zoo. Comme guide, je faisais confiance à mes souvenirs ayant été là-bas plusieurs fois. Et, après tout, une fois au zoo, il suffisait de suivre, entre un regard émerveillé et un autre, l’enchainement des cages. Le 13 avril, à Lyon, du point panoramique près de la cathédrale St. Paul à Fourvière, nous sommes descendus par le chemin à zigzag qui traverse le parc empêtré dans la colline. C’est l’afghan G. qui nous l’avait suggéré. « We go down, it’s better, short, I know it… », insistait-il. C’était plus court pour rentrer et plus facile car il connaissait déjà le chemin. Pendant le retour, les pas étaient souvent plus pressés, l’idylle de la marche flottante ne tenait plus. Voilà les marcheurs érythréens, afghans, albanais prendre un pas plus décidé sans carte, sans GPS, car ils connaissaient déjà les lieux, mus par l’envie de rentrer ou d’aller ailleurs.
C’était souvent un soulagement quand je leur donnais une réponse positive à leur question rituelle « Finit ? ». Le fait de retourner sur nos pas, clôturait un cadre d’interactions pour en annoncer petit à petit un autre (mais pas tout à fait « autre » que le premier). Ainsi, au début, il y avait la lenteur, les occasionnels récits partagés, la pause « syndicale » du gouter partagé, le tout dans une ambiance de légèreté et, par la suite, l’envie de chaque groupe d’aller dans un lieu ou dans un autre, la déperdition donc (mais pas toujours, le gros du groupe pouvant aussi demeurer stable et quelques garçons continuant à me parler par moments). Enfin, le ré-attachement aux conforts du métro ou tram où chacun regagnait sa bulle personnelle, en silence. Tout cela, bien sûr, sans carte!
En écho à l’anthropologue B. Guy (2015), nous étions « pèlerins » en ville et non « cybernautes », car nous n’avions pas besoin de se repérer à l’aide des « totems » du satellite ou la carte. On s’en sortait sans autre moyen que nos jambes. C’est à travers cela d’abord que les migrants étaient des acteurs du territoire. Ils marquaient leurs traces sur les routes, en marchant en autonomie, en faisant confiance à leur sens de l’orientation. Et puis, si certains avaient, au départ, du mal à se repérer sur ce nouveau territoire, ces balades donnaient l’occasion de voir leur progressive familiarisation et appropriation des lieux de la ville.
A.M.
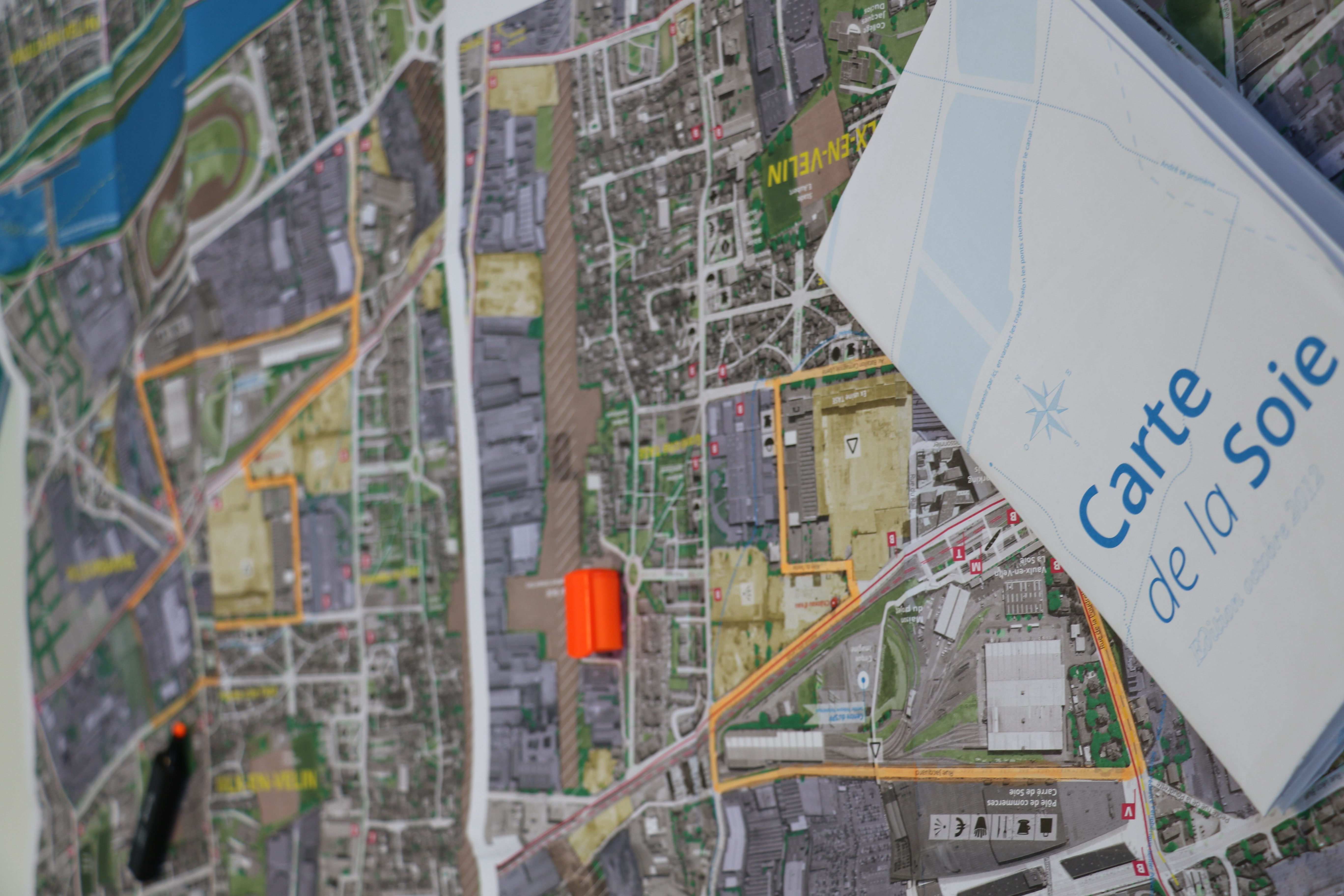



Laisser un commentaire
Vous devez être dentifié pour poster un commentaire.